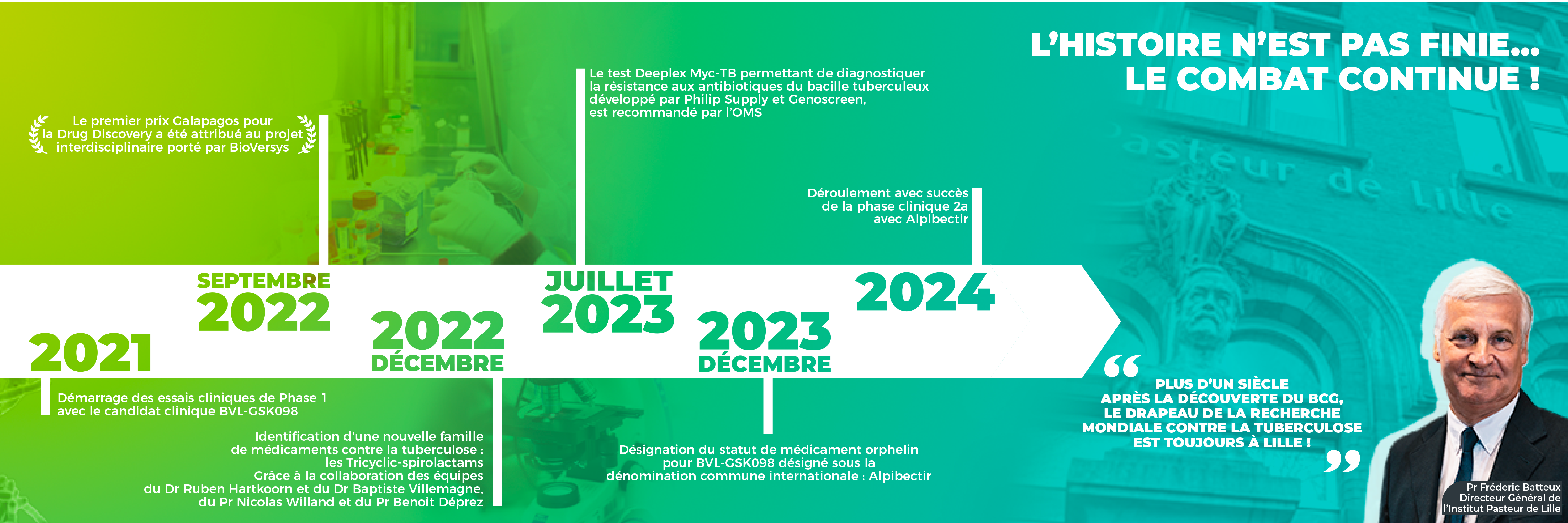Le parcours professionnel du Dr. Carine Rouanet, chercheuse à l’Institut Pasteur de Lille, est axé sur l’étude des interactions hôte-pathogène et le développement de nouvelles approches vaccinales.
Initialement concentrée sur le développement de nouveaux vaccins contre la tuberculose pour pallier les lacunes du BCG, elle a plus récemment travaillé sur l’efficacité d’administrations conjointes de vaccins ciblant les nouveaux nés. En effet, l’administration simultanée de vaccins, surtout chez les jeunes enfants, facilite la logistique et est souvent mieux acceptée par les parents, mais elle n’est possible que si l’absence d’interférences entre les vaccins a été confirmée. Carine Rouanet a ainsi évalué chez un modèle pré-clinique l’efficacité de la co-administration de deux vaccins vivants issus de la recherche menée à l’Institut Pasteur de Lille : le BCG contre la tuberculose et BPZE1, vaccin nasal contre la coqueluche actuellement en développement clinique en partenariat avec ILIAD Biotechnologies (Etats-Unis) et qui est issu des travaux de recherche des Drs N. Mielcarek, C. Locht et de leurs collègues au sein du Centre d’Infection et d’Immunité de Lille. Carine Rouanet a montré que non seulement il était possible de co-administrer ces deux vaccins sans altérer leur efficacité protectrice respectivement contre Bordetella pertussis et Mycobacterium tuberculosis, mais également que la co-administration de BPZE1 et du BCG, protégeait contre l’infection par le virus de la grippe. Ces résultats montrent que BPZE1 pourrait être administré en même temps que le BCG, ce qui faciliterait son intégration dans le calendrier de vaccination des enfants.
Un autre axe de recherche développé par le Dr Carine Rouanet consiste à explorer le devenir intracellulaire de Bordetella pertussis, responsable de la coqueluche, et Mycobacterium canettii, ancêtre environnemental de M. tuberculosis. Ces travaux qui combinent des aspects fondamentaux et translationnels, pourraient permettre d’identifier de nouvelles cibles moléculaires pour le développement de stratégies de lutte innovantes contre B. pertussis et M. tuberculosis.

Dr. Carine Rouanet, chargée de recherche au Centre d’Infection et d’Immunité de Lille au sein de l’équipe “Recherche sur les Mycobactéries et les Bordetelles“
Quelle est votre expertise principale et où travaillez-vous ?
Carine Rouanet (CR) : Je suis chargée de recherche à l’Institut Pasteur de Lille depuis 2003 et je travaille actuellement au sein de l’équipe ”Recherche sur les Mycobactéries et les Bordetelles”, dirigée par le Dr Nathalie Mielcarek. Ma formation initiale est celle d’ingénieure INSA pluridisciplinaire en biologie, complétée par un doctorat en microbiologie fondamentale. En 2002, j’ai rejoint l’IPL en tant que chercheuse postdoctorale au sein de l’équipe du Dr. Camille Locht. Depuis mon arrivée à l’Institut Pasteur de Lille (IPL), je m’intéresse au développement de nouvelles approches vaccinales et à l’étude des interactions hôte pathogène avec des recherches axées principalement sur les mycobactéries.
Pourquoi le développement de nouveaux vaccins contre la tuberculose est-il nécessaire ?
CR : Je tiens à rappeler ici que le seul vaccin actuel contre la tuberculose est le BCG qui est issu de la recherche menée à l’Institut Pasteur de Lille par les Drs Albert Calmette et Camille Guérin ! Le BCG protège efficacement les enfants contre les formes disséminées de la maladie, mais l’immunité protectrice induite par ce vaccin diminue à l’âge adulte et le BCG s’avère peu protecteur contre la forme pulmonaire de la tuberculose, qui est la plus fréquente dans cette population. Par ailleurs, chez les individus infectés, la tuberculose va rester la plupart du temps sous forme latente pendant de nombreuses années mais dans environ 5% des cas il va y avoir passage de la forme latente vers la forme active de la maladie, et le BCG n’est pas capable de prévenir cette étape de réactivation. Enfin, ce vaccin est contre indiqué chez les patients VIH+ qui présentent un risque élevé de développer une BCGite disséminée. L’objectif de la communauté scientifique est donc de développer un vaccin capable de répondre à ces différentes problématiques.

Quel est l’intérêt d’une administration conjointe du BCG et de BPZE1 ?
CR : Dans un premier temps, BPZE1 est envisagé comme vaccin de rappel pour les enfants d’âge scolaire, les adultes et les personnes âgées. Mais l’objectif final est de protéger les nouveau-nés, qui constitue la population la plus vulnérable face à la coqueluche. Donner plusieurs vaccins en même temps, surtout chez les tout-petits, présente plusieurs avantages. D’une part cela réduit le nombre de visites chez le pédiatre mais surtout cela peut faciliter l’acceptation de la vaccination par les parents. Mais avant d’adopter cette stratégie, il faut vérifier que l’administration simultanée des vaccins ne diminue pas leur efficacité. C’est pour cela qu’en collaboration avec le Dr. N. Mielcarek nous avons étudié l’efficacité d’une administration conjointe de BPZE1, candidat vaccin contre la coqueluche bientôt en phase 3 d’évaluation clinique, et du BCG qui est administré à plus de 100 millions de nouveaux nés chaque année. Nos travaux, réalisés chez des modèles précliniques de trois semaines, ont montré que cette co-administration n’affectait ni la protection offerte par BPZE1 contre la coqueluche ni celle induite par le BCG contre la tuberculose, et que la protection hétérologue induite par BPZE1 contre le virus de la grippe était également maintenue. Cette étude a donc démontré la faisabilité d’une co-administration de BPZE1 avec le BCG ce qui faciliterait à terme son intégration dans le calendrier vaccinal des jeunes enfants.
Nos travaux portent sur l’étude des interactions hôte-pathogène en analysant plus particulièrement le rôle des macrophages alvéolaires qui constituent des acteurs majeurs de l’immunité innée ayant un rôle clé dans le cas d’infections respiratoires telles que la coqueluche ou la tuberculose.
CR : La protection hétérologue fait référence à la capacité d’un vaccin vivant à conférer une protection contre des pathogènes autres que celui pour lequel il a été spécifiquement conçu. Dans le cas du BCG, une réduction de la mortalité et de la morbidité toutes causes confondues a été observée chez les nourrissons ayant reçu ce vaccin. La protection hétérologue induite par le BCG cible un large éventail de pathogènes, comprenant à la fois des bactéries et des virus. Contrairement à BPZE1, nous avons montré que la protection hétérologue induite par le BCG contre le virus de la grippe est dépendante de l’âge des modèles précliniques lors de la vaccination. Nous étudions désormais l’impact d’autres paramètres tels que le sexe et la voie d’injection, en cherchant à décortiquer les mécanismes fondamentaux sous-jacents, en lien avec le concept d’immunité entraînée (trained innate immunity).
CR : Nos travaux portent sur l’étude des interactions hôte-pathogène en analysant plus particulièrement le rôle des macrophages alvéolaires qui constituent des acteurs majeurs de l’immunité innée ayant un rôle clé dans le cas d’infections respiratoires telles que la coqueluche ou la tuberculose. Dans le cas de B. pertussis, l’objectif est d’analyser son devenir intracellulaire, de caractériser les voies de dégradation mises en jeu par le macrophage pour éliminer la bactérie et également de déterminer si le pathogène est capable de détourner à son profit les défenses mises en jeu par la cellule hôte puisqu’il existe des études qui suggèrent que B. pertussis pourrait persister dans les macrophages. Nos travaux visent à identifier les facteurs de virulence potentiellement impliqués.
En parallèle, je m’intéresse également au devenir intracellulaire dans les macrophages alvéolaires de Mycobacterium canetti. Cette bactérie pourrait constituer un ancêtre environnemental de Mycobacterium tuberculosis. Les souches de M. canettii peuvent causer une tuberculose chez l’homme mais elles présentent une restriction géographique très marquée qui se limite à la Corne de l’Afrique, et aucun cas de transmission inter humaine n’a jamais été rapporté. De plus, chez des modèles précliniques ces souches présentent une persistance très diminuée comparativement à M. tuberculosis. Tout cela suggère que les souches de M. canettii sont moins adaptées à l’infection et à la persistance chez l’hôte que M. tuberculosis. L’idée du projet est donc de comparer le devenir intracellulaire du pathogène professionnel que constitue M. tuberculosis avec celui de M. canettii pour établir si le défaut de persistance observé pour cette dernière pourrait s’expliquer au moins en partie par une prise en charge différente de la bactérie par les voies de dégradation.
De façon plus large, la comparaison du devenir intracellulaire de Mtb versus M. canettii de même qu’une meilleure compréhension des mécanismes de dégradation intracellulaire de B. pertussis pourraient conduire au développement de nouvelles stratégies de lutte contre ces deux pathogènes respiratoires.