La Dr Laurye Van Maele est chercheuse Inserm au Centre d’Infection et d’Immunité de Lille. Spécialiste des infections respiratoires bactériennes, elle étudie les mécanismes qui régissent les interactions entre les bactéries et notre système immunitaire. Ses travaux visent à développer des stratégies innovantes de prévention et de traitements. Dans un contexte de montée de l’antibiorésistance et de fragilisation des défenses immunitaires liée à des facteurs environnementaux (pollution de l’air…), elle explore de nouvelles pistes pour prévenir ou mieux traiter ces infections.
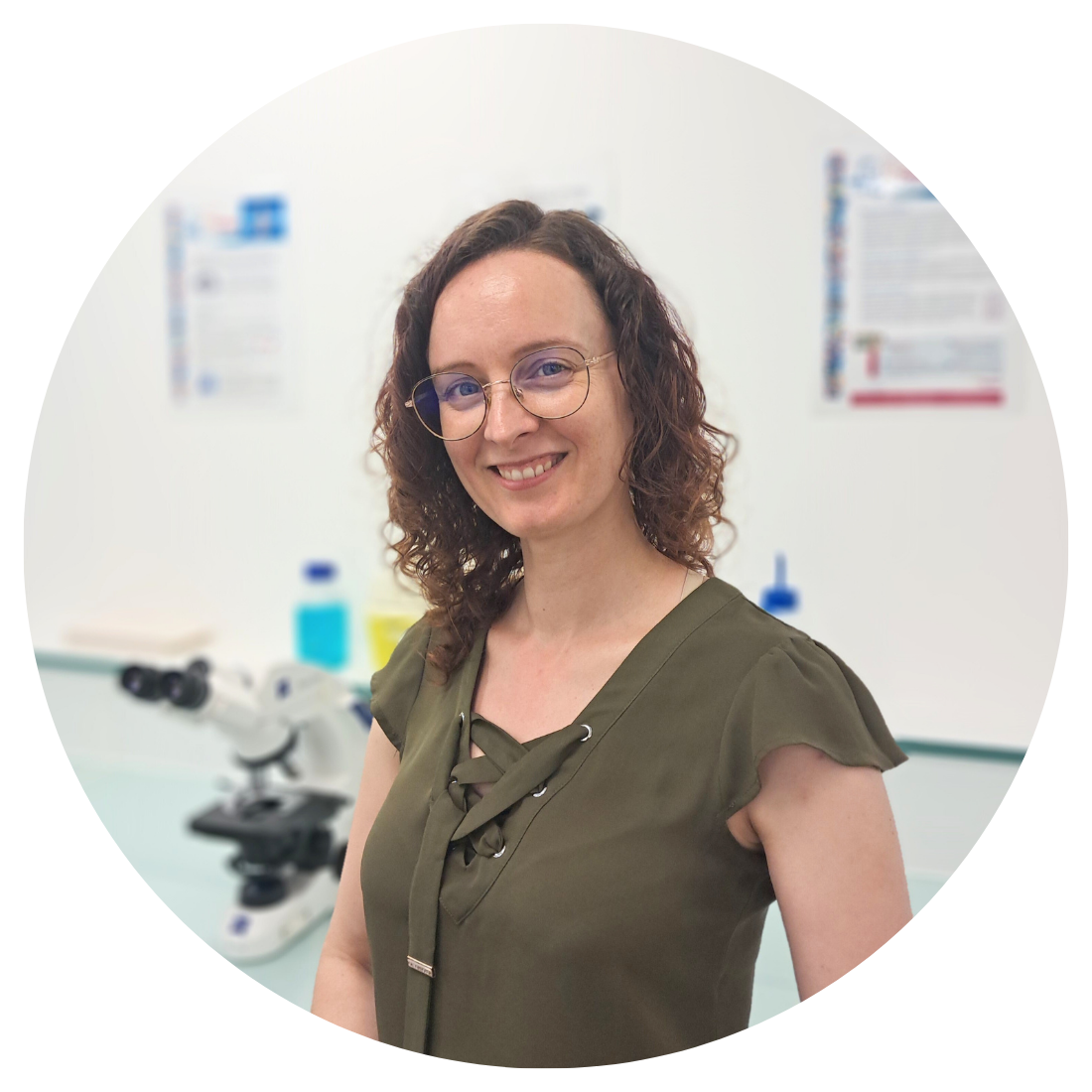
La Dr Laurye Van Maele, chercheuse INSERM à l’Institut Pasteur de Lille au sein de l’équipe “Bactéries, Antibiotiques et Immunité” au Centre d’Infection et d’Immunité de Lille
Vous êtes aujourd’hui chercheuse à l’Inserm, spécialiste des infections respiratoires. Quel a été le fil conducteur de votre parcours scientifique et quelles sont les grandes questions qui vous animent aujourd’hui ?
Laurye Van Maele (LVM) : Depuis le collège, j’ai toujours été fascinée par les bactéries et leurs interactions avec l’être humain. Très tôt, je me suis dit : comprendre ce qui se passe quand on est infecté, c’est ce que je veux faire. C’est ce qui m’a naturellement orientée vers une formation scientifique à l’Université de Lille : licence, master, puis doctorat.
J’ai réalisé ma thèse à l’Institut Pasteur de Lille. À la base, j’avais une formation en microbiologie, et c’est vraiment la bactériologie qui m’attirait. Mais au fil du temps, je me suis intéressée à l’immunologie, qui est très liée : comprendre l’une aide à comprendre l’autre. J’ai travaillé sur une molécule appelée flagelline, une protéine du flagelle bactérien, pour essayer de comprendre comment elle interagit avec le système immunitaire. On a vu qu’en utilisant cette flagelline, on était capable de traiter les infections. Elle avait un vrai potentiel, soit comme médicament, soit comme antigène vaccinal.
Après ma thèse, je suis partie faire un post-doc en Belgique, à l’Institut d’Immunologie Médicale sur le campus de Gosselies de l’Université Libre de Bruxelles. J’y ai travaillé sur le psoriasis, mais très vite, j’ai eu envie de revenir aux bactéries ! Heureusement, on m’a permis de développer un petit projet en parallèle.
Aujourd’hui, je suis chargée de recherche à l’Inserm, au Centre d’Infection et d’Immunité de Lille. Ce qui m’anime, c’est de comprendre les mécanismes qui se mettent en place au cours des infections : comment le pathogène interagit avec l’hôte, comment l’organisme réagit, et comment on pourrait intervenir pour mieux prévenir ou traiter ces maladies. Dans notre équipe, on s’intéresse notamment aux bactéries responsables de pneumonies, comme Streptococcus pneumoniae ou Klebsiella pneumoniae, en lien avec l’enjeu majeur que représente la résistance aux antibiotiques.
La pneumonie reste l’une des principales causes de mortalité infantile dans le monde, et le pneumocoque joue un rôle central dans cette infection. En quoi ce pathogène représente-t-il encore aujourd’hui un défi majeur de santé publique ?
LVM : Streptococcus pneumoniae (le pneumocoque) est responsable de plus de 190 millions d’infections par an dans le monde et 1,2 million de décès, malgré l’existence de vaccins.
Le pneumocoque est une bactérie à Gram positif, commensal des voies respiratoires supérieures, c’est-à-dire qu’on peut en être porteur sans être malade. Il cause généralement des infections ORL bénignes, mais chez les enfants, les personnes âgées ou immunodéprimées, il peut provoquer des infections invasives graves comme des pneumonies ou des méningites, souvent après un épisode grippal.
La transmission se fait par inhalation de microgouttelettes en suspension dans l’air, particulièrement en hiver où 50 % des enfants peuvent être porteurs.
C’est pourquoi la vaccination est cruciale dès la crèche et chez les personnes âgées. Les vaccins actuels ciblent la capsule bactérienne, mais ne couvrent qu’une vingtaine des plus de 100 sérotypes existants.
Notre équipe travaille sur le développement d’un vaccin universel utilisant un antigène qui est conservé chez les pneumocoques, avec l’objectif d’un vaccin nasal plus efficace. On a déjà montré sa protection en modèles précliniques, mais il reste à optimiser la formulation. C’est un vrai défi !
La pollution, surtout en lien avec le réchauffement climatique, pose un vrai problème. Lors des pics de pollution, on respire plus de particules fines qui irritent nos poumons, créant une inflammation et rendant nos voies respiratoires plus vulnérables aux infections.
Vous vous intéressez aux liens entre environnement et pneumocoque. Concrètement, quels facteurs environnementaux influencent la transmission ou la sévérité des infections ?
LVM : Pour bien se protéger contre les infections, c’est surtout notre système immunitaire qui fait la différence. Mais ce système n’est pas toujours au top : s’il est trop jeune, trop vieux ou affaibli, il ne peut pas bien nous défendre. Et beaucoup de facteurs dans notre environnement — la pollution, le tabac, l’alcool, le stress, pour ne citer qu’eux — peuvent fragiliser notre immunité. Quand elle est affaiblie, on devient plus sensible aux infections, comme celles causées par le pneumocoque. Si on est porteur, on transmet plus facilement, et si on est vulnérable, on risque de développer une infection plus grave.
La pollution, surtout en lien avec le réchauffement climatique, pose un vrai problème. Lors des pics de pollution, on respire plus de particules fines qui irritent nos poumons, créant une inflammation et rendant nos voies respiratoires plus vulnérables aux infections. C’est pour ça qu’adopter une bonne hygiène de vie et prendre soin de l’environnement, c’est essentiel. Protéger la nature, c’est aussi se protéger soi-même.
Certaines personnes sont particulièrement fragiles, comme celles sous traitement immunosupresseurs ou atteintes de pathologies chroniques comme l’asthme. Elles doivent faire attention et surtout se faire vacciner. Le vaccin contre le pneumocoque ne protège pas contre tous les types, mais contre les plus dangereux, ce qui limite la gravité des infections, un peu comme pour la grippe.
Avec le vieillissement de la population, on va forcément voir plus de cas de pneumonies. En vieillissant, on développe parfois des maladies respiratoires comme la BPCO, qui rendent plus vulnérables. En plus, un mode de vie moins sain — tabac, alcool, excès de sucre et de gras — favorise aussi des maladies comme le diabète ou l’obésité, qui affaiblissent notre système immunitaire.
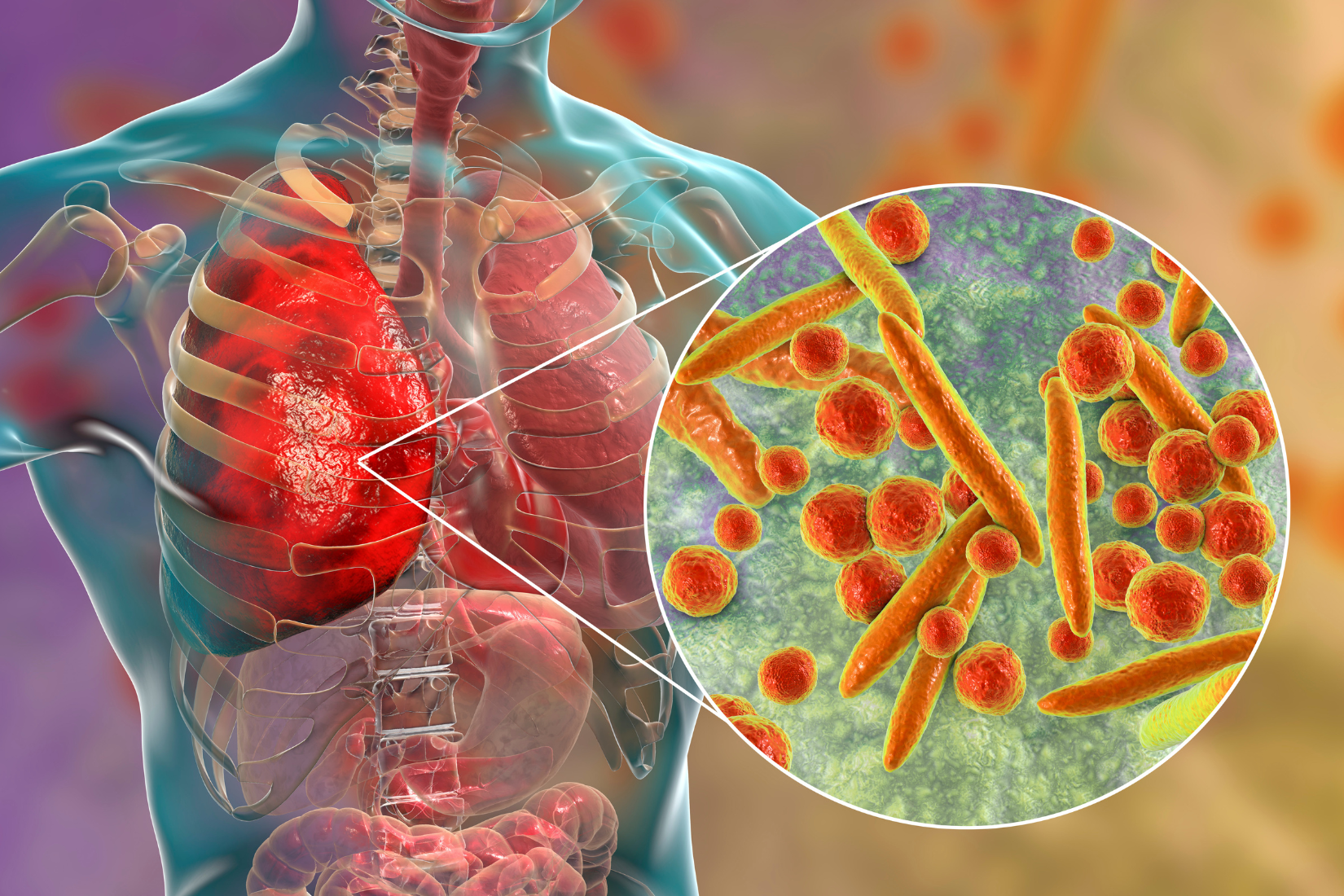
Comment vos travaux permettent-ils d’envisager de nouvelles pistes pour prévenir ou mieux traiter ces infections ?
LVM : Notre équipe s’intéresse aux mécanismes de défenses mis en place en réponse aux infections dans le but de développer de nouvelles immunothérapies pour lutter contre les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Nous développons deux approches complémentaires : les vaccins et les traitements par immunostimulateurs.
La vaccination est un moyen d’éviter la maladie. Sans maladie, pas de traitement par antibiotique. Un traitement qui pourrait se révéler inefficace à cause de l’antibiorésistance et favoriser l’émergence de bactéries résistantes. La vaccination reste donc un outil clé.
Lorsque la maladie est déjà déclarée, il faut alors aider notre corps à se défendre. Le traitement par immunostimulateur va permettre de renforcer notre système immunitaire. Parce que c’est ce système qui combat et élimine finalement les bactéries. En résumé, on développe à la fois de nouveaux vaccins et des aides pour booster l’efficacité des antibiotiques.
Un exemple concret : on a développé un produit appelé Flamod, basé sur une molécule appelée flagelline, sur laquelle j’ai travaillé durant ma thèse. Flamod est un traitement par inhalation qui vise à stimuler localement le système immunitaire au niveau des poumons, pour mieux lutter contre des infections déjà en cours, comme celles à pneumocoque.
Flamod est actuellement en phase I des essais cliniques, une étape importante pour tester son inocuité chez l’homme. C’est un projet porté principalement par le Dr. Jean-Claude Sirard. Il travaille également avec des spécialistes en sciences humaines et sociales, comme le Pr. Delphine GrynBerg, qui étudie l’acceptabilité de ce nouveau traitement auprès des patients.
Ce travail pluridisciplinaire est essentiel pour avancer vers des solutions innovantes qui pourraient améliorer la prise en charge des infections résistantes aux traitements et renforcer la protection des patients.
LVM : Il a été estimé qu’en 2050, la première cause de mortalité dans le monde sera due aux infections résistantes aux traitements. Face à cette menace, plusieurs stratégies complémentaires sont explorées. Dans notre équipe, la recherche se concentre sur le développement de vaccins – pour prévenir l’infection et donc éviter le recours aux antibiotiques – et sur des molécules capables de stimuler l’immunité afin de renforcer la réponse de l’organisme une fois l’infection déclarée. En parallèle, d’autres équipes du campus, comme celle du Dr. Ruben Hartkoorn, travaillent sur des boosters d’antibiotiques pour réactiver ou augmenter l’efficacité des molécules déjà existantes, avec notamment la collaboration du Dr. Marion Flipo. Des approches différentes mais toutes guidées par la même urgence : celle de trouver des alternatives viables à l’usage systématique des antibiotiques. Car les résistances apparaissent de plus en plus vite – parfois quelques mois seulement après l’introduction d’un nouvel antibiotique – alors que le développement de nouvelles classes se heurte à des difficultés majeures, notamment des effets secondaires importants. Les bactéries à Gram négatif posent un défi particulier. Elles sont capables d’acquérir rapidement de multiples résistances aux antibiotiques et elles déclenchent des infections systémiques fulgurantes. Une situation qui souligne l’urgence d’innover pour préserver l’efficacité des traitements.
