Chaque année, le printemps annonce le retour des beaux jours, et des allergies au pollen. La plupart du temps bénignes se traduisant par une rhinite allergique, des formes plus sévères peuvent apparaître, notamment chez les personnes avec une fragilité respiratoire, comme de l’asthme par exemple. La Dr Patricia de Nadaï de l’équipe “Immunité Pulmonaire“, nous explique comment des erreurs de plantation passées ont favorisé des espèces d’arbres très allergènes, et nous décrit ses recherches sur l’impact du CO2, un polluant en augmentation, sur la production et la qualité du pollen, et la nécessité de poursuivre la recherche pour des traitements efficaces.
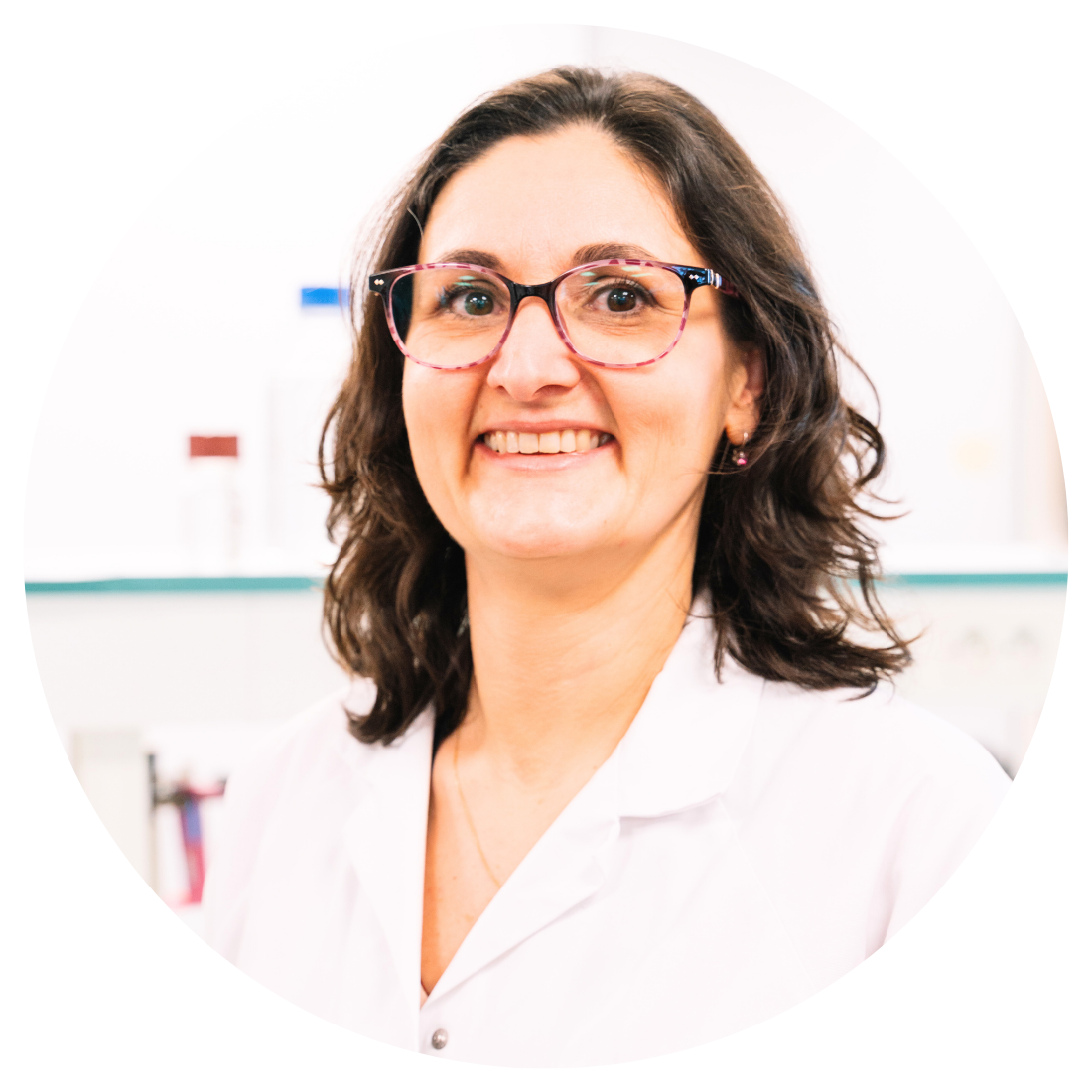
La Dr Patricia de Nadaï, Maîtresse de conférences à l’Université de Lille, mène ses travaux de recherche au sein de l’équipe “Immunité pulmonaire” (Centre d’infection et d’immunité de Lille) à l’Institut Pasteur de Lille
En période de printemps, le retour des allergies aux pollens est fréquent. A-t-on commis des erreurs dans le passé lors des plantations dans nos espaces verts urbains qui pourraient expliquer cette situation ?
Patricia de Nadaï (PDN) : En effet, des erreurs ont été commises dans le choix des espèces plantées dans nos villes. De nombreux arbres à croissance rapide produisant une grande quantité de pollen très allergisant ont été privilégiés. C’est le cas du cyprès dans le sud de la France, et du bouleau dans le nord. Avec le recul, les municipalités reconnaissent ces erreurs et cherchent à remplacer ces espèces par des alternatives plus rustiques émettant moins de pollen ou un pollen moins allergène. Des études récentes se penchent sur le micocoulier, un arbre à croissance rapide, résistant au froid et nécessitant peu d’eau, qui produit très peu de pollen sans provoquer d’allergies connues à ce jour. De plus, ses baies comestibles attirent les oiseaux, ce qui présente un avantage environnemental supplémentaire. Ces efforts de remplacement sont actuellement plus marqués dans le sud en raison des problèmes de sécheresse, mais pourraient s’étendre au nord à terme.
Certains polluants atmosphériques peuvent-ils aggraver les symptômes d’allergie aux pollens ?
PDN : De nombreux polluants peuvent interagir avec le pollen et exacerber les allergies. Les particules de pollution peuvent transporter le pollen, et certains gaz comme le CO2 jouent un rôle dans la croissance des plantes. Le CO2, un polluant généré par la production d’énergie, le transport, l’industrie, le chauffage…, est essentiel à la photosynthèse et à la croissance végétale. Une concentration accrue de CO2 entraîne une croissance plus rapide des plantes et une production de pollen plus importante. Des recherches en laboratoire étudient l’impact des niveaux de CO2 prévus pour 2050-2100 (un doublement par rapport aux taux actuels) sur une graminée très allergisante, la fléole des prés, très présente en Europe. L’objectif est d’évaluer si une croissance plus rapide due à un excès de CO2 modifie la qualité du pollen, le rendant potentiellement plus fragile et susceptible de libérer plus facilement ses allergènes.
L’objectif principal de ces travaux est de sensibiliser les pouvoirs publics et le grand public aux conséquences potentielles de l’augmentation du CO2 sur les allergies, en particulier celles liées aux graminées, sur lesquelles nous avons peu de contrôle une fois qu’elles sont implantées dans l’environnement.
Comment se déroulent concrètement les études en laboratoire de l’impact du CO2 sur le pollen ? À quel moment et comment intervenez-vous dans ce processus de recherche ?
PDN : Les plantes, comme la fléole des prés, sont cultivées à l’Université de Lille dans des chambres de culture où la concentration de CO2 est contrôlée pour simuler les conditions atmosphériques futures. Des équipes de biologistes végétaux étudient différentes populations de plantes collectées dans divers environnements (urbains, ruraux) et de différentes régions d’Europe. Ils mesurent leur vitesse de croissance, le nombre d’épis et la quantité de pollen produite. Une croissance plus rapide des plantes due à un excès de CO2 pourrait entraîner la production d’un pollen moins mature, dont la paroi serait plus fragile. Normalement, les allergènes sont encapsulés dans le grain de pollen et sont libérés lorsque celui-ci éclate (par exemple, au contact d’une surface ou de l’humidité). Si la paroi du pollen est plus fragile, il risque de se rompre plus facilement, libérant ainsi une plus grande quantité d’allergènes. De plus, la période de pollinisation pourrait s’étendre (démarrer plus tôt, finir plus tard et durer plus longtemps), augmentant la durée d’exposition aux allergènes.
Pour ma part, mon intervention consiste à évaluer le potentiel allergisant de ce pollen produit dans différentes conditions de CO2. Nous travaillons avec des cultures de cellules humaines immunitaires pour observer si le pollen issu d’une atmosphère riche en CO2 induit une réponse immunitaire allergique plus forte. Nous mesurons notamment la sécrétion de cytokines, des molécules impliquées dans la réaction allergique, à l’aide de tests ELISA. Nous collaborons également avec des physicochimistes qui analysent les caractéristiques physiques du pollen et avec des chercheurs de l’Institut Pasteur de Paris qui étudient la reconnaissance de ces pollens du futur par des anticorps de patients allergiques .
PDN : D’autres polluants comme l’ozone peuvent également modifier les caractéristiques du pollen. Des études ont montré que l’exposition à l’ozone peut entraîner des modifications dans les lipides présents à la surface des grains de pollen. Ces modifications lipidiques peuvent potentiellement augmenter le caractère allergisant du pollen. Bien que nous n’ayons pas spécifiquement abordé les particules fines dans cette discussion, il est établi qu’elles peuvent transporter le pollen et potentiellement irriter les voies respiratoires, exacerbant ainsi les symptômes allergiques.
PDN : L’objectif principal de ces travaux est de sensibiliser les pouvoirs publics et le grand public aux conséquences potentielles de l’augmentation du CO2 sur les allergies, en particulier celles liées aux graminées, sur lesquelles nous avons peu de contrôle une fois qu’elles sont implantées dans l’environnement. Il est crucial de prendre en compte cet impact dans les politiques d’aménagement urbain et de déconseiller la plantation d’espèces très allergisantes dans les jardins publics, par exemple. Ces recherches visent également à anticiper les vagues de maladies allergiques respiratoires au niveau hospitalier et à souligner la nécessité de disposer d’un système de santé capable d’absorber l’afflux de patients lors des pics de pollinisation. À plus long terme, il est impératif de poursuivre la recherche pour développer des traitements plus efficaces contre ces pathologies allergiques.
Les allergies au pollen se manifestent-elles uniquement par des symptômes respiratoires légers, ou peuvent-elles entraîner des formes plus sévères comme l’asthme ?
PDN : Les allergies au pollen se manifestent fréquemment par une rhino-conjonctivite allergique, ce que l’on appelait autrefois le rhume des foins, avec des symptômes tels que le nez qui coule, les yeux qui piquent et qui larmoient. Cependant, chez une partie des patients, notamment ceux qui sont déjà asthmatiques ou poly-allergiques, l’exposition au pollen peut déclencher de l’asthme (asthme saisonnier au pollen). Dans les cas d’asthme sévère, la maladie nécessite une prise en charge médicamenteuse importante pour stabiliser l’état du patient. Même une rhino-conjonctivite sévère peut être très handicapante et ne pas répondre correctement aux traitements habituels, pouvant entraîner des complications comme la formation de polypes nasaux.

PDN : On observe une augmentation de la fréquence des allergies en général, touchant environ 20% des adultes et une proportion croissante de jeunes, avec des formes de plus en plus sévères. Cette augmentation est probablement multifactorielle, liée à l’exposition accrue aux polluants atmosphériques, au changement climatique qui peut intensifier et prolonger les périodes de pollinisation, et potentiellement à d’autres facteurs environnementaux comme l’exposition aux microplastiques. L’irritation des voies respiratoires par la pollution peut également sensibiliser les individus et potentiellement favoriser le développement d’allergies chez des personnes prédisposées génétiquement.
