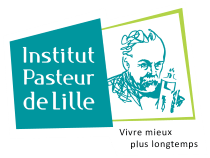Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde. On compte chaque année 10 millions de nouveaux cas. La maladie d’Alzheimer, à l’origine de 60 à 70 % des cas, est la cause la plus courante de démence. C’est une maladie multifactorielle. Elle est en effet due à plusieurs causes. Certaines sont non modifiables, tels que l’âge ou les facteurs de prédisposition génétiques. Il existe aussi des facteurs de risques environnementaux qui peuvent être modifiés s’ils sont pris en charge : l’hypertension artérielle, le diabète, le tabac, l’obésité, la sédentarité. Plus récemment, plusieurs études ont également proposé que des agents infectieux pouvaient être pointés du doigt, notamment certains virus comme celui de la Covid-19. Alors doit-on s’attendre à un pic de nouveaux cas d’Alzheimer d’ici quelques années ? Le Dr Jean-Charles Lambert, reconnu mondialement pour son expertise en génétique sur la maladie d’Alzheimer, et Directeur de recherche à l’Institut Pasteur de Lille nous répond.
– Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer, et comment se manifeste-t-elle ?
J-C. Lambert : La maladie d’Alzheimer est causée par une lente dégénérescence des neurones. La mémoire à court terme est la première affectée (dégénérescence des neurones au niveau de l’hippocampe), puis la maladie s’étend petit à petit à l’ensemble du cerveau.
La définition actuelle de la maladie d’Alzheimer repose sur la présence de dépôts de peptides amyloïdes bêta (Aβ) appelés plaques amyloïdes ou plaques « séniles » dans le cerveau, autour de neurones, mais aussi autour de vaisseaux sanguins cérébraux. Des enchevêtrements de protéine tau anormale sont également présents dans le cerveau des personnes atteintes. En ligne avec l’hypothèse amyloïde, la recherche thérapeutique s’est, depuis une vingtaine d’années, principalement tournée vers l’identification de substances capables de réduire la production d’Aβ dans le cerveau.
– Quels sont les facteurs favorisant l’apparition de la maladie ?
JCL : Ils sont nombreux, c’est pour cette raison que l’on parte d’une maladie multifactorielle. On distingue bien évidemment les facteurs de risque de base : l’âge, premier facteur de risque d’Alzheimer, le sexe, le niveau d’éducation et le patrimoine génétique. Il y a des facteurs de risque environnementaux : le tabagisme, une alimentation déséquilibrée et un taux élevé de certains lipides dans le sang et l’inactivité physique. En fait la liste est longue, 14 facteurs environnementaux modifiables sont connus, et nous n’avons certainement pas encore établi le lien entre la maladie et tous les facteurs possibles.
– Peut-il y avoir une association entre certaines infections virales et la maladie d’Alzheimer ?
JCL : Les conclusions de récents travaux vont dans ce sens. Il a été découvert que certains virus comme le virus Herpès simplex-1 (HSV-1) peuvent contribuer au développement de la maladie. Les mécanismes à l’origine de ce phénomène font l’objet de travaux qui visent notamment à élucider le rôle des virus pathogènes dans la formation des lestions de la pathologie. Une étude renforce l’hypothèse d’un rôle du HSV-1 dans la maladie d’Alzheimer. La détection de protéines virales dans le cerveau des patients, en interaction avec la protéine tau, suggère un mécanisme initialement protecteur qui, à terme, pourrait favoriser la neurodégénérescence. Une interaction gène-virus est probable. Plusieurs mécanismes pourraient expliquer que l’association soit retrouvée uniquement chez les porteurs de l’allèle epsilon 4 du gène de l’apolipoprotéine E (APOE), connu pour augmenter le risque de maladie d’Alzheimer. Le virus pourrait par exemple pénétrer plus facilement dans les cellules neuronales des porteurs de l’allèle ApoE4, pour y avoir des effets délétères. Il est aussi possible que ces derniers aient une capacité moindre à réparer les lésions induites par le virus. Les investigations ne sont donc pas terminées.
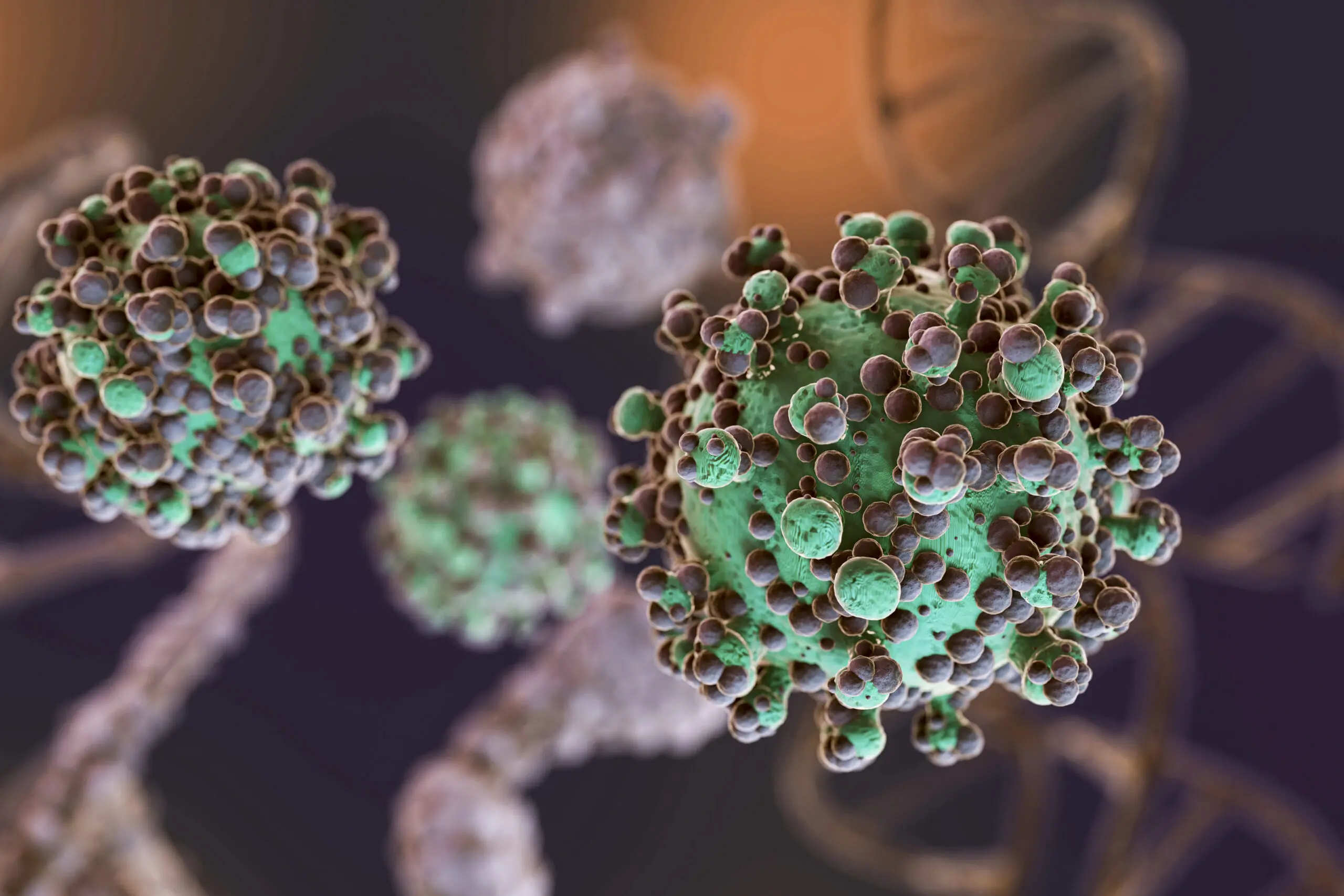
– Le virus de la Covid-19 fait-il partie des agents infectieux suspectés de causer à terme de nouveaux cas d’Alzheimer ?
JCL : Bien sûr les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont plus vulnérables face au SARS-Cov2 responsable de la Covid-19, en raison de l’âge moyen des personnes atteintes d’Alzheimer. Cependant il semblerait que la Covid-19 accélère l’apparition clinique de la maladie chez des personnes qui étaient déjà fragiles cognitivement. Le virus en lui-même a probablement un impact sur le cerveau. C’est sans doute une des grandes craintes du corps médical à la suite de la pandémie que nous avons connue entre 2020 et 2022, et à la circulation du Coronavirus qui se poursuit. Là encore plusieurs études récentes montrent de quelles façons ce virus, notamment dans les formes dites de Covid-19 longs, peut atteindre notre cerveau. Une étude récente à montrer que la Covid-19 conduisait à une augmentation de la production de peptides amyloïdes dans le sang. Nous manquons donc cruellement de recul pour savoir comment le Sars-cov2 va impacter le risque de développer la maladie d’Alzheimer dans les décennies à venir. Nous ne pouvons qu’encourager pour l’instant à éviter de trop multiples infections et de se faire vacciner. Un énorme travail reste donc à faire pour comprendre les implications de cette nouvelle pandémie à moyen et long terme.
– De façon général, est ce que les vaccinations contre de nombreuses infections peuvent protéger de la maladie d’Alzheimer ?
JCL : De nombreuses maladies infectieuse sont actuellement associées à une augmentation du risque de développer la maladie d’Alzheimer comme la grippe par exemple. Des études tendent ainsi à rechercher un lien possible entre vaccination et développement de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit d’études épidémiologiques compliquées à mettre en place en raison de nombreux biais et facteurs de confusions qui peuvent exister au sein de ce type d’étude, pouvant rendre les interprétations compliquées. Cependant, il apparait que plusieurs de ces études ont montré un effet protecteur possible de la vaccination pour de nombreuses approches vaccinales. Par exemple, une étude récente a même montré que la vaccination régulière contre la grippe après 40 ans pouvait réduire de près de 40% le risque de développer la maladie d’Alzheimer. Nous ne savons pas vraiment les mécanismes impliqués mais cela ouvre une approche préventive des démences.
Pour conclure, la piste virale qui se renforce concernant la maladie d’Alzheimer, et notamment le lien potentiel entre la COVID-19 et un risque accru de maladie d’Alzheimer, met en lumière l’importance d’une vigilance accrue et de recherches supplémentaires dans ce domaine et dans nos connaissances en général sur la maladie d’Alzheimer.
En savoir plus sur nos recherches :
Combattre la maladie d’Alzheimer, un des défis que les chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille se sont fixés pour vivre mieux plus longtemps
A l’Institut Pasteur de Lille, un laboratoire d’excellence est dédié à cette maladie. Connaitre la génétique de la maladie est une étape essentielle pour proposer de nouvelles cibles thérapeutiques. L’objectif de nos chercheurs est donc de décrypter la susceptibilité génétique liée à la maladie d’Alzheimer pour mieux la combattre.
L’équipe du Dr Jean-Charles Lambert, parmi les leaders mondiaux en génétique sur la maladie d’Alzheimer, est à l’origine de la découverte de 75% des déterminants génétiques responsables de la maladie. Le Dr Lambert pilote, depuis Lille, un consortium réunissant 18 pays pour cartographier les gènes liés à la maladie.
La connaissance de la génétique permet de mieux comprendre les processus des effets pathologiques mis en place au cours du développement de la maladie. Elle permet donc de proposer de nouvelles cibles thérapeutiques.
La France sera amenée à connaître une forte croissance des cas d’ici à 2040, passant de 17 à 24 cas pour 1 000 habitants, soit une augmentation de +40 % ! Elle compte 1 million de personnes touchées par la maladie Alzheimer, dont deux fois plus de femmes que d’hommes.
Chiffres pour la France :
- 1 million de personnes touchées
- 8% des français de plus de 65 ans atteintes en 2020
- 7% au-delà de 75 ans
- 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année
« Nous avons fait d’énormes progrès, mais il reste encore beaucoup à découvrir par l’utilisation d’approches très pointues tel que le séquençage du génome complet pour chaque malade » souligne J-C. Lambert.