L’asthme : une pathologie pulmonaire fortement influencée par l’environnement
Mise à jour : octobre 2024
Asthme, pollution de l’air et enjeux de santé publique
L’asthme provient de l’association d’une prédisposition génétique à l’allergie, également appelée « atopie », et de facteurs environnementaux favorisants, dont la pollution. De plus en plus les enfants sont concernés, et les adultes plus généralement. Les dernières enquêtes nationales montrent une prévalence de l’asthme de plus de 10 % chez l’enfant âgé d’au moins dix ans et une prévalence de l’asthme actuel de 6 à 7 % chez l’adulte. Chez ce dernier, l’asthme peut être allergique ou non allergique, alors que chez l’enfant l’asthme allergique est prédominant. Les enfants qui sont actuellement touchés par l’asthme présentent un risque plus élevé d’être asthmatiques à l’âge adulte et de présenter des formes plus sévères de la maladie.
Un individu est exposé à l’environnement dès sa conception, à sa naissance durant toute sa vie. Nous sommes donc face à un continuum d’exposition aux polluants.
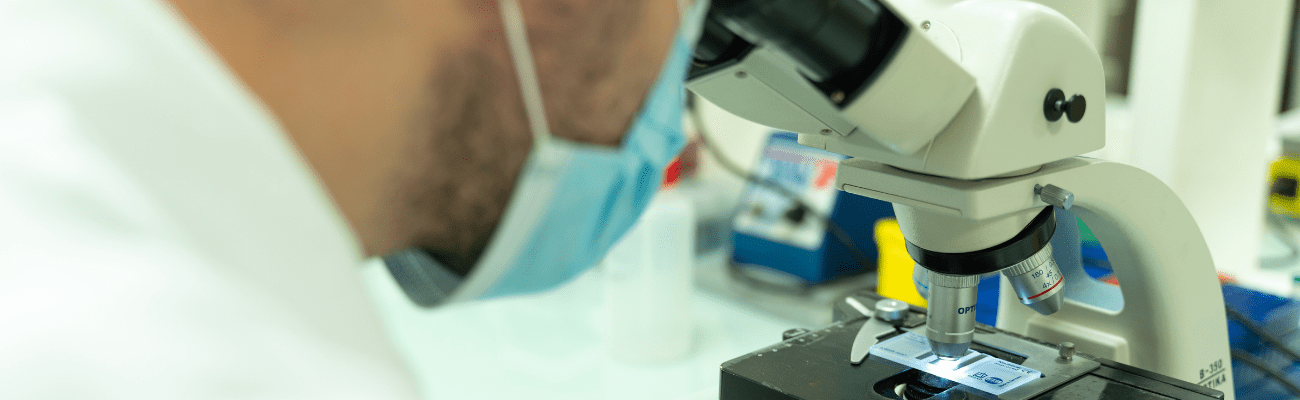
Comment mieux diagnostiquer l’asthme et adapter les thérapies ?
Les travaux de recherche menés à l’Institut Pasteur de Lille par le Dr Patricia De Nadai et son équipe portent sur deux axes : l’asthme sévère d’une part, et l’impact des micropolluants et de la pollution en général sur la pathologie d’autre part. Les recherches ciblent le système respiratoire, en collaborations avec d’autres laboratoires qui travaillent sur l’appareil digestif qui est un lieu important d’éducation du système immunitaire. Il est ainsi possible de récupérer des échantillons afin d’étudier les modifications que l’exposition aux particules ultrafines peut engendrer au niveau intestinal.
L’objectif des chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille est de déterminer de nouveaux biomarqueurs pour mieux diagnostiquer et adapter les thérapies. En travaillant en forte interaction avec les médecins et chercheurs du CHU de Lille, notamment les pneumologues qui font partie intégrante de l’équipe de recherche, l’équipe est en mesure de mener des recherches translationnelles, et ainsi d’améliorer la prise en charge des patients. A noter qu’il existe plusieurs thérapies disponibles pour l’asthme allergique, notamment les biothérapies (anticorps neutralisant des médiateurs de l’allergie), mais le corps médical est le seul à décider du choix de la thérapie qui sera appliquée.
Pour en savoir plus : “Une équipe Lilloise trouve une parade pour contrôler l’asthme aux acariens“
-
La pollution extérieure
La pollution extérieure due, entre autres, aux gaz d’échappement, aux chauffages urbains, à l’industrie et à l’agriculture…, est constituée d’aérosols très complexes. Ces derniers vont, en plus, dépendre du type de pollution, de la saison, du moment de la journée, du type de carburant, ce qui rend leur étude très complexe.
Aujourd’hui, les équipes de l’Institut Pasteur de Lille cherchent des susceptibilités en fonction de pathologie respiratoire. En effet, une personne asthmatique va être plus sensible à la pollution, car outre la présence d’un terrain inflammatoire, l’élimination des particules au niveau de l’arbre bronchique va être plus longue et elle sera donc exposée plus longtemps.
-
La pollution intérieure
Nous passons environ 80 % de notre temps à l’intérieur d’un local fermé, à la maison et/ou au bureau, dans la voiture, qui sont des lieux largement autant exposés à la pollution extérieure qu’à la pollution intérieure. En effet, de nombreux Composés Organiques Volatiles (COV) tels que le formaldéhyde ou le benzène, entrent dans la composition de colle sur certain mobilier, ou moquette dans des mousses isolantes… « Certes, les quantités ne sont pas importantes, mais nous sommes alors soumis à une exposition continue, on parle d’exposition chronique ». Les chercheurs tentent de mieux appréhender les effets de la pollution intérieure.
Exposition environnementale et mode de vie
Une collaboration avec le laboratoire de toxicologie de l’université de Lille permet de disposer d’échantillons de particules collectés dans l’environnement, et donc principalement composés de particules de carbone issues d’une pollution industrielle et routière. Malgré le mécanisme de clairance pulmonaire*, toutes ces particules, en raison de leur très faible taille vont pouvoir pénétrer très profondément dans le poumon et atterrir dans les alvéoles où s’opèrent les échanges gazeux, et se retrouver dans le sang. Des études ont montré que ces particules peuvent passer de la mère à l’enfant via le placenta, ou encore que l’exposition in utero à la fumée de cigarette va favoriser le développement des pathologies respiratoires, notamment l’asthme, et que cela est transmissible à la descendance sur 2 ou 3 générations. Il s’agit donc potentiellement de mécanismes épigénétiques (qui ne modifient pas la séquence de l’ADN mais modifie sa lecture) qui sont mis en jeu avec une transmission des mauvais fonctionnements de gènes. Les travaux menés par les équipes de l’Institut Pasteur de Lille visent à démontrer que nous pouvons avoir le même phénomène avec les particules ultrafines de l’environnement.
L’allergie comporte donc une partie génétique, et on sait à présent qu’il existe des gènes associés au risque de survenue d’une allergie et notamment de l’asthme. Il s’agit de combinaison de gènes de susceptibilité. Les facteurs impliqués dans le développement de la maladie sont l’exposition environnementale (exposome) et le mode de vie. L’asthme est une maladie qui est donc fortement influencée par l’environnement. Ainsi, des séquences génétiques vont être plus favorisantes au développement de la pathologie, mais la pathologie va se développer parce que l’environnement y est favorable.
* Dans les voies respiratoires, la couche de mucus séquestre les agents inhalés et progresse, grâce aux battements ciliaires des cellules sous-jacentes, vers la glotte. Le mucus est continuellement avalé ou expectoré, ce qui définit le mécanisme de clairance pulmonaire.
Faut-il aérer sa maison tous les jours ?
Bien que les études portent essentiellement sur l’air extérieur et l’impact des micropolluants, il existe aussi des données publiées sur l’air intérieur concernant les particules, ainsi que sur les solvants et les aérosols. Les études s’intéressent aux patients atteints de pathologies respiratoires, et dans moindre mesure à la population générale, car ce sont les patients fragiles qui vont subir l’impact le plus important et immédiat de la pollution sur leur santé.
Patricia De Nadai le confirme, il faut aérer nos foyers et en renouveler l’air pour remédier à la concentration de polluants intérieurs qui augmente. Mais cela doit être fait au moment de la journée où le taux de polluants est le moins élevé, très tôt le matin donc, avant que la circulation se mette en route. Il faut également aérer les logements pour lutter contre l’exposition aux allergènes. L’allergie la plus répandue est celle due aux acariens qui prolifèrent à une température et un taux d’humidité élevés. L’absence d’aération des logements vont favoriser ces conditions de température et d’humidité, et augmenter la population d’acariens, et donc le taux d’allergène.
L’asthme dû aux acariens est très répandu et concerne plus de la moitié des patients.
Quel est l’impact du changement climatique sur la production de pollens allergisants ?
Un projet de recherchant bénéficiant d’un financement de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) vise à étudier l’impact du changement climatique sur la production de pollens allergisants, en collaboration avec des biologistes végétaux, des physico-chimistes, et des immunologistes.
Le réchauffement climatique a une influence sur l’émergence et la prolifération de certaines plantes. L’ambroisie, par exemple, une graminée normalement restreinte au sud de la France et à l’est de l’Europe migre vers le nord de l’hexagone. Les équipes de l’Institut Pasteur de Lille évaluent dans ce projet les capacités de prolifération des plantes et de production de pollen de graminées allergisants dans des conditions atmosphériques proches de celles modélisées pour 2050. Sur le plan de la santé humaine, les équipes évaluent l’effet de ces pollens sur les cellules immunitaires de sujets sains et de patients allergiques. Le but étant de comprendre les modifications environnementales liées au changement climatique, d’anticiper un accroissement de la sensibilisation à ces allergènes et donc une augmentation du nombre de patients dans les services hospitaliers, et d’en alerter les autorités.
Quels sont les effets de la pollution de l’air sur la santé ?
La pollution de l’air touche pratiquement chacun d’entre nous. On estime que près de 7 millions de décès sont associés à la pollution de l’air extérieur et intérieur, soit environ 12 % de l’ensemble de décès mondiaux. La pollution de l’air peut avoir des impacts sur tout et tout le monde. L’OMS estime que 36% des cancers du poumon sont liés à la pollution. 35% des BPCO, 34 % AVC, 27% maladie cardiaque. Encore plus effrayant, aujourd’hui l’OMS affirme que 90% de la population urbaine ne respire pas un air sain.
La pollution environnementale (particules fines, monoxyde de carbone, dioxyde de souffre, oxydes d’azote, ozone, benzène, hydrocarbures et métaux lourds) serait à l’origine de 3,7 millions de décès prématurés dans le monde. Elle est la principale cause de décès par cancer (28%), soit 31 000 morts par an en France (en augmentation chez la femme). Il est prévu une augmentation de l’incidence des cancers d’ici 2030 (+45% à 190%). Les taux régionaux de mortalité (standardisés monde) par cancer du poumon sur la période 2004-08 varient de 36,6 pour 100 000 en Midi-Pyrénées à 57,3 pour 100 000 dans le Nord-Pas-de-Calais.
Cette pollution produite par les usines, les véhicules à moteur, l’agriculture ou encore les phénomènes naturels (incendies, pollens, volcanisme…) a une incidence directe sur la santé respiratoire et cardiovasculaire. La taille des particules est liée à leur potentiel toxique. Les polluants induisent la production de molécules profibrotiques responsables de la fibrose péri bronchique, et de metalloprotéases responsables de l’emphysème.
Le diesel représente un facteur déterminant de l’augmentation de prévalence et de morbidité des maladies allergiques en agissant non seulement sur les réponses allergiques préétablies mais aussi sur leur genèse.
Les pics de pollution augmentent la mortalité chez les malades atteints d’affections cardio-respiratoires chroniques, augmentent les consultations en urgence et les admissions hospitalières pour causes respiratoires et cardio-vasculaires chez les malades atteints d’insuffisance respiratoire chronique, d’asthme, de BPCO,……et sont associés à une diminution de la fonction ventilatoire chez l’enfant. Les enfants sont particulièrement à protéger. Les femmes enceintes doivent aussi se protéger pour protéger leur enfant (de nombreux polluants sont présents dans le sang du cordon)
La pollution de l’air intérieur est également très impactante pour les personnes asthmatiques ou sensibles. Les allergènes de nos habitations sont en effet partout : les plantes, les literies, les moquettes, les zones humides… On parle donc beaucoup des moisissures, des acariens, des pollens, des produits d’entretien, du tabac, des parfums d’ambiance … On n’insistera jamais assez sur la nécessité de l’aération du logement, pratique capitale mais trop peu répandue et sur l’intérêt de rester bien informés : connaître les périodes critiques pour les émissions de pollen dans la région, lire les étiquettes des produits ménagers… pour éviter les erreurs ou les pratiques à risques !
Itinéraire d’une chercheuse
Patricia De Nadaï, un souffle d’espoir dans la lutte contre l’asthme
Patricia de Nadaï est maître de conférences à la faculté de médecine de Lille et fait partie de l’équipe de recherche sur l’immunité pulmonaire d’Anne Tsicopoulos.
Très jeune déjà, elle savait qu’elle souhaitait étudier la biologie, l’enseigner et faire de la recherche. Pour être chercheur, on lui dit qu’il faut que le parcours scolaire passe par les grandes écoles. Qu’à cela ne tienne, elle suivra la filière universitaire, bien plus formatrice, selon elle.
Alors qu’elle doit choisir un laboratoire et qu’elle a le choix entre Marseille, Toulouse et Lille, elle opte pour la capitale des Hauts-de-France. Avant tout pour les sujets de recherches du laboratoire d’Anne Tsicopoulos. Elle confie : « J’avais beau avoir davantage étudié la biologie moléculaire et génétique, ce sont les travaux menés sur l’asthme allergique qui ont motivé mon choix. “ Comment inhiber les cellules pour que le patient aille mieux ? ” est un sujet très concret. Nous avons la chance de travailler avec des patients. Je ne connaissais pas du tout l’Institut Pasteur de Lille. L’excellence des recherches qui y sont menées m’a séduite. »
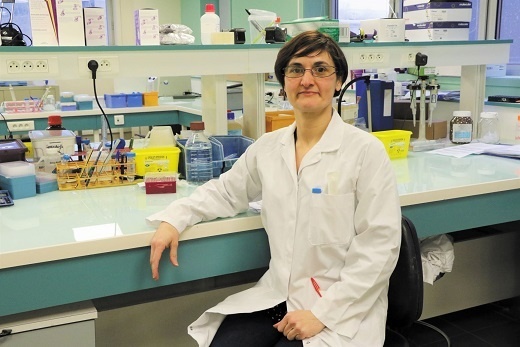
Au sein de l’équipe, nos travaux portent sur l’asthme allergique et plus particulièrement sur ses formes sévères « car c’est là où il y a le moins d’options thérapeutiques pour les patients », déclare Patricia de Nadaï. « Comment se déclenche l’asthme ? Pourquoi ? Comment peut-on aider le patient ? » sont autant de questions auxquelles elle tente de répondre.
« Nous nous intéressons à l’effet des nanoparticules sur l’apparition de l’asthme ou son aggravation. Le but est de réussir à les contrer au sein du système immunitaire. On ne pourra jamais empêcher qu’il y ait des nanoparticules dans l’atmosphère ou sur le tissu pulmonaire, mais on peut essayer d’en minimiser les effets », décrypte Patricia de Nadaï.
À l’Institut Pasteur de Lille, elle se considère chanceuse. Elle conclut : « Ici, nous avons l’avantage de bénéficier de nombreux plateaux techniques. Nous avons accès à différentes technologies et nous échangeons beaucoup entre équipes de recherche. Tout cela n’est rendu possible qu’avec le soutien des donateurs. »
Thématique de recherche
Merci à Pascale Bauge, bénévole à l’Institut Pasteur de Lille, pour sa contribution à ce dossier.

