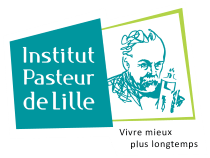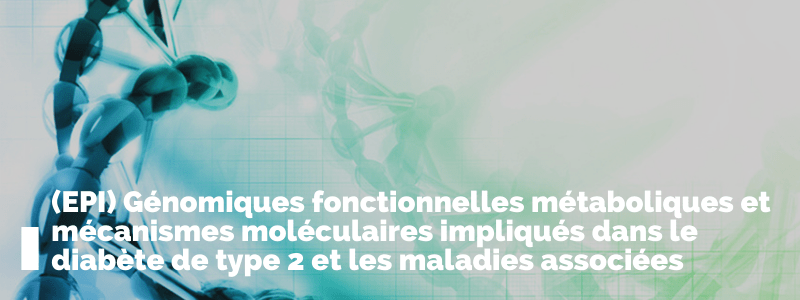Diabète et obésité
Bien que leur origine génétique soit différente, l’obésité et le diabète sont deux maladies très liées. En effet, l’obésité est le premier facteur de risque du diabète et 80% des obèses sont diabétiques. Pire encore, si le diabète se développe dans le monde, c’est parce que de plus en plus de personnes sont obèses ou en surpoids. L’obésité et le diabète sont deux maladies qui empêchent de bien vieillir en bonne santé et réduisent l’espérance de vie des malades. Le diabète est un axe fort des recherches menées à l’Institut Pasteur de Lille, grâce au soutien de donateurs et partenaires.

Mieux comprendre le diabète
Plus de 4,5 millions de personnes en France sont diabétiques, mais environ 1 million d’entre elles l’ignorent ! La situation est particulièrement préoccupante dans la région Hauts-de-France où l’association de facteurs génétiques et sociaux entraîne un risque de diabète de type 2 et d’obésité significativement supérieur à la moyenne nationale : 5,5 % de la population. Le diabète se caractérise par un taux anormalement élevé de glucose (ou sucre) dans le sang appelée aussi hyperglycémie. Le glucose apporte l’énergie aux différents tissus de l’organisme. Si le taux de glucose dans le sang reste stable même après un repas ou après un effort physique, c’est qu’il existe un système régulateur complexe dans lequel l’insuline joue un rôle primordial puisque c’est elle qui assure l’entrée et/ou l’utilisation du glucose par les cellules.
Le diabète de type 1
Le diabète de type 1 (environ 5 % des cas de diabète en France) est une maladie auto-immune, c’est-à-dire une maladie inflammatoire chronique qui résulte d’un dysfonctionnement immunitaire et qui peut toucher différents organes. L’insuline est une hormone synthétisée dans les cellules bêta du pancréas elles-mêmes situées dans les îlots de Langerhans, c’est l’hormone régulatrice du taux de glucose (sucre) dans le sang. Le diabète de type 1 a pour origine une sécrétion insuffisante d’insuline par le pancréas, qui détruit peu à peu les cellules bêta. Ce diabète se manifeste généralement dès l’enfance ou l’adolescence. Le corps ne fabriquant plus du tout d’insuline, l’unique traitement actuellement disponible reste l’apport régulier d’insuline (par injection) associé à une alimentation équilibrée et une pratique sportive régulière.
Le diabète de type 2
Dans le diabète de type 2, c’est la glycémie qui ne réagit plus à l’insuline sécrétée par le pancréas. Il est aussi appelé “diabète non-insulino dépendant” (DNID) ou “diabète gras” et peut être diagnostiqué plusieurs années après l’apparition des premiers symptômes. Le glucose est alors mal utilisé par les cellules, expliquant l’élévation de la glycémie au-dessus des valeurs normales (hyperglycémie). Plus fréquent que le diabète de type 1, ce diabète se manifeste généralement après l’âge de 40 ans. Plusieurs types de traitements peuvent être proposés en complément d’une alimentation équilibrée.
L’hyperglycémie est avérée dès lors que le taux de glycémie à jeun est égal ou supérieur à 1,26g / l de sang. La glycémie se mesure en autosurveillance grâce à un appareil, le plus souvent à partir d’une goutte de sang prélevée à l’extrémité du doigt.
Il existe aussi d’autres formes plus rares de diabète comme le diabète gestationnel (diabète temporaire qui survient chez 6% des femmes enceintes) ou le diabète MODY (Maturity Onset Diabetes Of the Young), un diabète lié à la mutation d’un gène qui représenterait 2 à 5 % des diabètes non insulino-dépendants.
Les recherches sur le diabète et l’obésité à l’Institut Pasteur de Lille
L’unité de recherche sur la génétique du diabète et de l’obésité a été créée à l’Institut Pasteur de Lille en 1995. Elle est composée de cinquante personnes, chercheurs enseignants et ingénieurs. Cette unité est à l’origine du laboratoire d’excellence (labex) EGID et de l’équipement d’excellence de génomique (equipex) LIGAN médecine personnalisée, au service de la recherche médicale et des patients victimes de maladies génétiques ou de cancers.
L’objectif de l’EGID est d’offrir des conditions optimales d’une recherche “translationnelle” sur le diabète de réputation mondiale améliorant réellement la vie des diabétiques. L’unité fonctionne en deux équipes. Une organisation qui a permis tout d’abord l’identification de nouvelles voies conduisant aux maladies métaboliques, puis à l’établissement de modèles cellulaires permettant leur étude précise, puis la mise au point de nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques.
Des équipes en particulier travaillent sur les origines génétiques du diabète. A ce titre, l’unité a été la première équipe au monde à démontrer l’existence de formes monogéniques de diabète et d’obésité, puis à explorer le génome des diabétiques et des obèses à la recherche de variants génétiques communs (études pangénomiques dites GWAS).
Si le diabète est bien souvent entraîné par l’obésité ou le surpoids et que la glycémie peut être améliorée grâce à un rééquilibrage alimentaire, la génétique peut également jouer un rôle dans son apparition. Le Pr Froguel précise que “l’obésité vient du cerveau et de l’intestin et concerne la régulation alimentaire, alors que le diabète vient du pancréas et de la sécrétion de l’insuline.”
En parallèle, une autre unité de l’Institut Pasteur de Lille étudie les interactions entre le diabète et les maladies cardiovasculaires. Elle étudie en particulier la régulation des gènes impliqués dans ces pathologies et les conséquences de leur dérégulation avec un intérêt particulier pour les récepteurs nucléaires qui constituent des cibles thérapeutiques potentielles. “Nous avons notamment identifié le rôle crucial d’un récepteur nucléaire dénommé PPARα dans le métabolisme du glucose (sucre) et nous avons identifié de nouvelles cibles thérapeutiques dont certaines sont actuellement en phase de test clinique”, explique le Pr Bart Staels.
C’est le cas notamment de l’Elafibranor, un médicament mis au point par la société lilloise Genfit qui joue sur ce type de récepteurs dans l’une des complications du diabète, la NASH (Non-Alcoholic Steato Hepatitis), une affection hépatique qui peut conduire à la cirrhose. Le médicament mis au point par Genfit sur la base des découvertes réalisées à l’Institut Pasteur de Lille a été testé avec succès sur 800 patients et volontaires sains en Europe et aux Etats-Unis, elle devrait rentrer bientôt en phase de test 3, la dernière avant la commercialisation.
Identifier les gènes responsables du diabète
En s’intéressant à la génétique et aux mutations de l’ADN, l’unité de recherche a démontré que des mutations rares étaient certainement à l’origine d’effets importants sur leur porteur, et que ce n’était pas les mutations fréquentes qui entraînaient forcément les maladies les plus répandues. Les équipes de cette unité mixte de recherche à l’Institut Pasteur de Lille, ont été les premières à identifier des gènes responsables du diabète. Aujourd’hui, 100 gènes sont identifiés comme responsables du diabète.
En 2017, l’unité a utilisé sa plateforme de séquençage de l’ADN unique en France pour trouver de nouveaux gènes d’obésité, mais aussi pour mieux diagnostiquer les diabètes de type 2 à début précoce d’origine génétique permettant enfin une médecine personnalisée de certains diabètes. L’unité a aussi exploré la fonction parfois mystérieuse de gènes impliqués dans le diabète de type 2 ouvrant de nouvelles voies de traitement. Elle a aussi débuté une étude ambitieuse, couronnée par l’European Research Council, sur les régions régulatrices du génome des cellules pancréatiques, du foie, tissu adipeux et muscles, tissus essentiels de la régulation de la glycémie. Elle a enfin mené des études sur l’effet épigénétique (modifiant l’activité génique) de l’environnement sur le métabolisme, et sur ses conséquences sur les complications hépatiques du diabète de type 2.
Quels sont les premiers signes de diabète ?
Les symptômes du diabète sont similaires pour les deux types. Le patient ressent souvent une fatigue anormale ainsi qu’une augmentation inhabituelle de la soif (polydipsie) et de la faim. Il est notamment fréquent de ressentir un urgent besoin d’uriner. De plus, il est courant de déclencher des infections et démangeaisons au niveau des parties génitales.
Quel est le lien entre diabète et obésité ?
L’obésité et le diabète présentent tous deux des facteurs risques de comorbidité. La comorbidité est définie par la présence de plusieurs maladies chroniques qui nécessitent un traitement sur le long terme.
Plus la quantité de graisse est importante dans le corps et plus l’organisme a besoin d’insuline. Le pancréas, d’où est synthétisée l’insuline, est surmené et s’il n’arrive pas à produire assez d’insuline (ou totale absence), alors le diabète peut se développer chez le sujet obèse. L’obésité peut donc être une cause du diabète.
Comment se pose le diagnostic du diabète ?
Le diabète est le plus souvent diagnostiqué à la survenue de symptômes.
On réalise tout d’abord une prise de sang pour doser la glycémie. Des examens complémentaires peuvent être prescrits par le médecin traitant ou le diabétologue.
| Diabète | Type 1 | Type 2 |
| Diagnostic suite à la prise de sang |
● à jeun, la glycémie est supérieure ou égale à 1,26g/l à deux reprises et qu’il n’y a pas de symptômes
● à n’importe quel moment de la journée, la glycémie est supérieure à 2g/l en présence de symptômes
|
● à jeun, la glycémie est supérieure ou égale à 1,26g/l et qu’elle est constatée à deux reprises
|
| Confirmation du diagnostic |
● bilan sanguin avec dosage de l’HbA1c (hémoglobine glyquée) ● bilan urinaire et rénal (créatinine, urée…) ● consultation ophtalmologique |
● seconde prise de sang ● examen clinique complet : ● calcul de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) ● examen cardiologique et neurologique ● bilan sanguin ( hémoglobine glyquée, cholestérol, fonction rénale…) ● consultation ophtalmologique (fond d’oeil) |
| Examens complémentaires |
● Electrocardiogramme (examen du coeur) ● Electromyogramme (examen de suivi des nerfs) ● Suivi dentaire |
|
“Le nombre de diabétiques va passer de 350 à 600 millions dans le monde. Pour l’instant, on n’a pas réussi donc il faut continuer. Il n’y a pas de quoi être fier mais plutôt motivé. Ce genre de recherche, ce n’est pas pour se faire plaisir. C’est une responsabilité sociale. Les gens nous font confiance. “